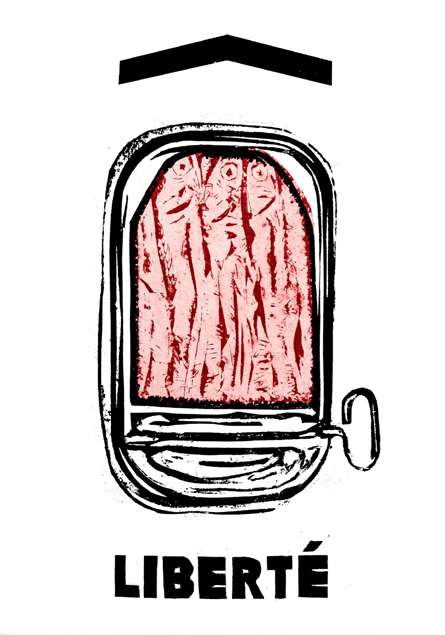« Siège de Saint-Martin » gravé par Jacques Callot en 1631
Retrouver chaque été une œuvre magistrale de Jacques Callot est toujours source de plaisir esthétique, de découvertes inédites voire d’énigmes à élucider. En effet, la médiathèque La Pléiade de Sainte-Marie de Ré possède1 et expose un « Siège de Saint-Martin », plus connu sous le titre « Le siège de l’île de Ré ». Il s’agit d’une des deux commandes passées par Marie de Médicis à Jacques Callot pour glorifier la prise de la ville rebelle de La Rochelle, en 1628, par les troupes royales commandées par ses deux fils, Gaston d’Orléans et le roi Louis XIII.
Il s’agit d’une gravure hors du commun à bien des égards. Composée de six grandes estampes à la française assemblées et accompagnées dans la marge inférieure d’un avertissement, l’un en latin l’autre en français, et d’une légende numérotée bilingue latin-français, cette œuvre présente une vue cavalière de l’île de Ré dessinée depuis le continent et orientée vers le sud situé ici vers le haut de la gravure. Cette impression d’excellente qualité ne comporte pas les dix estampes originelles de bordure. Celles-ci servaient d’encadrement aux six estampes principales. Ce cadre comprenait dans sa partie supérieure le titre de la composition, dans un médaillon central le portrait de Louis XIII gravé par Michel Lasne, deux cartouches de part et d’autre gravés par Jacques Callot, le tout était relié par des ornements composés de panoplies et de trophées gravés par Abraham Bosse. De la même manière sa partie inférieure, gravée par les mêmes artistes, reprenait cette disposition avec dans le médaillon central le portrait de Gaston d’Orléans. Sur sa partie gauche, en français, étaient gravées, en lettres cursives, une proclamation à la gloire du souverain et une légende numérotée de l’ensemble ; sur celle de droite les mêmes informations figuraient en latin.
Bien entendu, les six estampes centrales captent immédiatement le regard de l’amateur d’aujourd’hui. Assemblées côte à côte grâce à des repères alphabétiques en lettres capitales gravées dans le cuivre, elles brossent un vaste panorama comme vu d’une des machines de Cyrano de Bergerac. Sur la terre de l’île, fourmille une multitude de scènes de guerre avec force cavaleries, régiments de piquiers, d’arquebusiers et charrois de toutes sortes. Sur mer, s’alignent des embarcations de tous tonnages, de la simple chaloupe à de grands vaisseaux toutes voiles dehors. Comment ne pas se perdre dans un tel embrouillamini où les yeux s’égarent ? En s’approchant au plus près des estampes, on peut y distinguer de nombreux numéros, une quarantaine, gravés en chiffres arabes, qui renvoient à ceux de la légende et qui précisent la nature des différentes scènes. Comme le révèle Jacques Vichot dans son étude historique2 cette profusion est due à un artifice artistique. En effet dans cette vue générale, Jacques Callot a mêlé deux campagnes militaires distinctes chronologiquement, celle de 1625 avec la prise de l’île par les troupes royales et celle du siège de la citadelle de Saint-Martin de Ré par les Anglais et le débarquement victorieux pour lever ce siège par l’armée du roi Louis XIII en 1627.
Jacques Callot décrit ici trois débarquements réunis sur une même image, deux français et un anglais. Au XVIIe siècle comme aujourd’hui, les ingrédients de ces opérations militaires sont similaires : imposante armada de navires canonnant à feux roulants préalablement les défenses côtières pour les anéantir, lancement à marée basse des chaloupes d’assaut qui débarquent leurs soldats avec de l’eau à mi-cuisses, grèves du rivage jonchées de cadavres et de blessés, etc. Callot grave tout cela avec une précision et un réalisme diaboliques. Sur la droite des estampes le débarquement royal de 1625 aux Portes sur la plage de Trousse-chemise, à gauche le débarquement anglais de 1627 sur la pointe de Sablanceaux, au centre le débarquement venu au secours de la citadelle de Saint-Martin. Tous les personnages de ces opérations sont parfaitement campés dans leurs mouvements pris sur le vif. Comme leur taille n’excède pas de un à trois millimètres cheval compris, il faut regarder de près chaque scène attentivement. Le tout se déroulant sous un ciel serein à peine suggéré, tout en haut des estampes au-dessus de la ligne d’horizon, par quelques grands traits pâles qui dessinent de sages nuages clairs.

Partie inférieure gauche du « Siège de l’île de Ré » (Cl. Claude Bureau)
Avant la victoire royale, tout l’art de Callot se déploie sur une petite surface de deux estampes, en bas à gauche, au port du Plomb sur le continent où a lieu l’embarquement avant l’assaut final. Sous le regard du roi et de son frère, au premier plan, un officier sans doute, chapeau sous le bras et hallebarde à la main, presse sa troupe d’avancer. Plus loin et derrière le souverain, une activité fébrile règne dans le désordre afférent aux préparatifs d’un embarquement car la marée commande : des charrettes à deux ou quatre roues affluent pleines à ras bords, des mules lourdement chargées les précèdent, dans un va-et-vient des brouettes et des portefaix circulent vers les bateaux, des soldats en rangs serrés prêts à embarquer se hâtent vers les passerelles entre des accumulations de sacs de grains, de mousquets, de canons sans affût, de boulets, de tonneaux de poudre, de roues d’affût démontées, des matelots portant des brassées de piques ou de rames se dirigent vers les embarcations et une passerelle de planches ploie sous le poids d’un tonneau. Le tout gravé avec le souci d’un pittoresque un peu cru, comme ce chien qui défèque à droite au premier plan ou ce matelot situé un peu plus haut qui urine dans le flot.

Suite de la scène du port du Plomb sur la gauche (Cl. Claude Bureau)
Toutes ces scènes s’organisent de bas en haut avec un harmonieux effet perspectif rendu par le traitement des vagues de moins en moins sombres et de plus en plus minuscules jusqu’à la ligne claire de l’horizon. Même si, dans ces six estampes, cavaliers, soldats et matelots se canonnent, s’arquebusent, se mousquettent ou s’estoquent pour s’entre-tuer de belles manières, elles sont exemptes de gibets, estrapades, files de prisonniers entravés et autres incendies de villages, toutes horreurs bien présentes dans « Le siège de La Rochelle ». Réalités cruelles de toutes guerres comme des prémisses à celles que Jacques Callot allait, quelques années plus tard, mettre en scène dans son cahier gravé des « Misères de la guerre » édité par Israël Henriet. Comme quoi son génie artistique a-t-il su transfigurer cette commande de propagande, fût-elle royale, en une œuvre intemporelle et universelle.
Pourtant, une énigme demeure à résoudre. Comme le signale Jacques Vichot, les cuivres originaux des estampes de Jacques Callot ont été préservés. Ils sont passés de main en main avant d’être achetés par l’État en 1861 et conservés à la Chalcographie du Louvre. Cependant, les tirages de Sainte-Marie de Ré ne comportent pas les bordures originelles. Les trois estampes de la bordure inférieure sont gravées horizontalement à l’italienne alors que le texte et la légende, en français et en latin, des bordures originelles étaient gravés verticalement à la française. Si les légendes de ces bordures correspondent, en revanche les textes des placards diffèrent notablement. L’originel est gravé ainsi et proclame : « Callot à tous les potentats de la Terre et à tous ceux qui possèdent et dominent les mers pour la gloire perpétuelle du roy très Chrestien Louis le juste. Empereurs, Roys et Princes et toutes sortes de Souverains. Cette île de Ré que Callot représente l’une des moindres de celles qui sont habitées…/… ainsi que Callot la représente, faict à Paris le douzième Mars mil six cent trente et un. » En revanche, celui des tirages décrits ici est rédigé comme une réclame publicitaire : « Telle est l’Isle de Ré que Callot le Lorrain a représentée avec autant de justesse que d’exactitude, que de grâce, et de finesse à…/… dans la seconde estampe, pareille à celle de l’Isle de Ré qui a pour titre le Siège de la Rochelle. » Ce qui signifie typographiquement et textuellement nullement la même chose.
Par qui et quand ces trois cuivres ont-ils été gravés ? S’agit-il des cuivres de remplacement exécutés par le graveur Andreau en 1755 ? Ce mystère s’obscurcit encore plus car ces trois estampes sont identiques à celles que commercialise actuellement avec les six autres principales la Chalcographie du Louvre3. Pourquoi, alors que les estampes d’encadrement originelles sont présentes dans les tirages commandés par Jacques Vichot à cette même chalcographie pour en doter certains musées des départements maritimes et que l’on peut encore voir au musée Ernest Cognacq de Saint-Martin de Ré, ces trois estampes bien différentes figurent-elles dans le catalogue de la chalcographie et pas les dix estampes originelles ? Gageons que les fins limiers de l’histoire de l’art pourront peut-être répondre à toutes ces questions et éclaircir ces mystères. Mais, en attendant, allez admirer l’ensemble des six estampes du « Siège de l’île de Ré » gravées par Jacques Callot et exposées à Sainte Marie de Ré. Elles en valent la peine.
Claude Bureau
1 – don des enfants de Nicole Schladenhauffen (1933-2013), résidente hollandaise de cette commune des Charentes maritimes.
2 – «Les gravures des sièges de l’île de Ré et de La Rochelle (1625-1628) deux chefs-d’œuvre Jacques Callot – Étude descriptive & historique » par Jacques Vichot, directeur du musée de la Marine, 110 pages (1971). Elle est disponible dans la base de données Gallica de la Bnf en téléchargement gratuit.
3 – les six estampes du « Siège de l’île de Ré » et les trois estampes d’accompagnement sont disponibles sur commande et sur devis préalables auprès de la chalcographie.