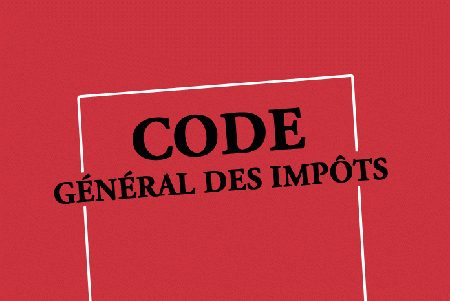Le vestibule de l’exposition avec Kim Eok et Jana Lottenburger
(Cl. Claude Bureau)
« Affinités-Rencontre de Gyeol »
Exposition de xylographies contemporaines
Centre culturel coréen
20 rue de la Boétie 75008 Paris
14 avril au 29 juin 2022
Si la xylographie est aux origines de l’estampe – impression sur une feuille de papier des reliefs d’une planche en bois gravée – et si elle connut son apogée avec les images des ouvrages de l’imprimerie typographique, elle connaît maintenant un regain d’usage parmi les artistes d’aujourd’hui grâce à ses qualités expressives particulières. Cette magnifique exposition au nouveau Centre culturel coréen en porte témoignage. Encore faut-il bien préciser la chose. Dans cet usage artistique, la matière de la matrice – le bois, sa texture, ses nervures ou ses veines, joue un rôle dans le rendu de l’image qu’il serait vain d’ignorer tant de la part du graveur que de la part du spectateur. Les matrices en bois debout de naguère – c’est-à-dire tranchées transversalement au tronc de l’arbre, comme le poirier ou le buis – sont devenues introuvables quoique parfois choisies dans d’autres essences en découpe brute pour leur effet artistique1. Mais la plupart des artistes xylographes contemporains doivent se contenter de ce qui reste disponible en bois ou de ses dérivés actuels : soit des planches en bois de fil – c’est-à-dire sciées longitudinalement au tronc d’arbre, planches que tout le monde connaît en différentes essences – ; soit des plaques de bois de fil déroulées contreplaquées les unes aux autres ; soit des plaques de linoleum composées de poudre de bois, d’huile de lin, de gomme arabique et de colorants ; soit des plaques de medium, beaucoup plus dense et rigide, composées de poudre de bois et de colles synthétiques particulièrement abrasives pour le tranchant des gouges et des outils.
Chacune de ces matières à graver possèdent ses propres vertus expressives. La planche de bois de fil ou celle de contreplaqué peuvent laisser transparaître à l’impression de l’épreuve les veines ou nervures du bois et nuancer de dégradés l’aplat des encres. La douceur du linoleum met en valeur des traits langoureux ou suaves sur la profondeur de denses et noirs aplats. Le medium plus dur contrebalance par des tailles plus sèches et nerveuses les noirs épargnés. Tous ces rendus possibles, jusqu’à des embossages du papier laissé vierge2, sont bien présents dans toutes les œuvres présentées ici dans leur diversité d’inspiration et d’exécution.
L’exposition occupe les six salles du deuxième étage de ce tout neuf Centre culturel coréen parisien. Le sobre accrochage mis en place et bien éclairé met en valeur les estampes telles qu’elles sortent de la presse. Ainsi ne subissent-elles ni le poids d’encadrements superflus ni de glaciales plaques de verre. Le grain des papiers chante chaleureusement sous la lumière. Les œuvres choisies ont été réunies sur trois thèmes : l’humain, la nature et la ville par les commissaires dont la principale Kim Myoung Nam. Cependant l’étrange et discrète place des cartels oblige-t-elle pour leur lecture à accomplir de nombreuses génuflexions, en signe de déférence aux œuvres présentées peut-être. Les travaux des artistes coréens impressionnent par leurs grandes dimensions et leur présentation souvent spectaculaire où se mêlent le papier, l’encre et bien d’autres choses mystérieuses.

La salle avec An Jeong Min et Min Kyeong Ah (Cl. Claude Bureau)
Dans le vestibule de l’exposition dominent sept grands kakemonos supportant en noir et blanc – couleurs d’ailleurs dominantes de toute l’exposition – de minutieux paysages de montagne de Kim Eok, artiste que l’on retrouve dans la dernière salle avec un immense panorama côtier déroulé et suspendu au plafond avec ses oiseaux marins, ses parcs à huîtres et ses bateaux de pêche. Sur le sol du vestibule s’affirme en contrepoint une installation de tétraèdres de dimensions variés de Jana Lottenburger. Dans la dernière salle, traités à la façon des années trente en forts contrastes, des sujets figuratifs rappellent la partition de la Corée : « Jeju 4.3 Requiem » de Hong Seon Wung, entre autres. Dans une autre salle, An Jeong Min défie le regard et la surface du mur avec imprimé sur une feuille de silicone brillante et jaspée : « Height-width-depth-ocean-print4 » où bouillonne en noir mat sa planche gravée. Un panneau est consacré aux linogravures dont celles de Min Kyeong Ah qu’elle a pour « Ongoing super » assemblées en un immense éventail circulaire, comme son collègue Kang Haeng Bok qui dans la grande salle a constitué avec des fils et des popups une haute stèle verticale : « Whaeon-A ».
Les artistes français invités ont quant à eux joué de partitions plus modestes quant à leurs dimensions, quoique. Anne Paulus montre dans « Higashimyo II » un morceau d’une sorte de tissu érodé par le temps et percé d’une multitude de trous. Jean Lodge, avec des encres verdâtres et brunes imprimées sur un patchwork vertical de vieux papiers rapiécés, dans « Immigrants II » au travers des veines du bois, fait apparaître une foule de visages indécis et épuisés. Les trois petites Madones de la série « Double vue » d’Alain Cazalis emmêlent xylographie, linogravure et collages de papier récupérés. Beaucoup plus surprenant, dans la grande salle, sont les deux très grands « Ex-nihilo » de Catherine Gillet qui abandonne là pour la première fois le burin et le cuivre. Malgré ce changement de matière et de taille, on y reconnaît sa manière expressive si personnelle et si méditative mais comme inversée dans ses reliefs et où dans ses très sombres aplats noirs sourdent les veinules du bois déroulé de la plaque gravée.

La grande salle avec Catherine Gillet (Cl. Claude Bureau)
Une exposition qu’il ne faut pas manquer de visiter tant par la qualité des travaux présentés que par la beauté architecturale du lieu qui les accueille. Un catalogue trilingue est édité pour l’occasion. La version papier semble épuisée mais sa version informatique, où on pourra lire avec profit les études de Philippe Piguet et de Kho Chung Hwan, est téléchargeable sur le site Internet du Centre culturel coréen de Paris
Claude Bureau
1 – Dans les vitrines de l’exposition sont présentées quelques tranches en bois gravées et leurs estampes ainsi que des planches rectangulaires d’une essence de bois très dense avec deux curieuses poignées ajoutées sans doute pour leurs manipulations ultérieures.
2 – Ainsi en ont décidé Kim Myoung Nam et Mickaël Faure dans leur œuvre à deux mains ; « À ceux-là ».