
Dans l’écho publié en avril 2022 sur la signature de l’estampe, je tentais de décrire les interrogations du stampassin débutant et l’expérience acquise par le stampassin chenu sur ce sujet (voir ici). Une chose apparaît certaine : l’un et l’autre signent aujourd’hui leurs estampes car ils les revendiquent comme leurs mais aussi comme des œuvres d’art. Leur signature est le signe extérieur, peut-être de leur richesse, voire de leur talent ou de leur notoriété mais surtout de la nature et de la substance de l’estampe signée, celle d’une œuvre d’art ! Cependant, qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? Cette question alimente les angoisses des rédacteurs et les cauchemars des correcteurs de dissertations bachelières. Comme le souligne Michel Melot : « C’est par sa qualité, croit-on, qu’un objet peut être qualifié d’œuvre d’art. Cette qualité étant relative, subjective et souvent indicible, l’œuvre d’art demeure indéfinissable. Les historiens et les philosophes ne savent donc pas ce qu’est une œuvre d’art. »1. D’autant plus que les artistes eux-mêmes, tels Duchamp, Dubuffet ou Arman, etc. ajoutent à chaque génération leur grain de sel et leurs empêchements de penser droit l’objet d’art. D’autres acteurs plus sages laissent le soin à la postérité le soin de la réponse. Toutefois, la postérité en infidèle est sujette à bien des revirements : on oublie aujourd’hui ce qu’on adorait naguère. Tous ces changements de pied font les délices de l’histoire de l’art. Cette question ouvre donc un champ de sables mouvants où nul ne saurait posséder de réponse définitive. Devant tant d’incertitudes et de volte-face, il fallait bien que les hommes politiques, qui pour la plupart ne manquent pas d’un certain culot, afin d’asseoir la perception des taxes, impôts et autres droits de douane, s’en mêlassent et décidassent quel objet était œuvre d’art ou pas.
Ce fut chose faite en France par l’article 16 de la loi de finances rectificative n° 94-1163 du 29 décembre 1994 dont le décret d’application n°95-172 du 17 février 1995, signé par Nicolas Sarkozy, alors ministre du budget et Édouard Balladur, premier ministre, stipule dans son article 2 deuxième alinéa comment est définie l’estampe comme œuvre d’art : « Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ; ». Voilà qui semble précis mais qui, malgré sa rédaction en termes très généraux, restreint passablement et exclut du champ des œuvres d’art bien des innovations contemporaines qui étaient encore à l’époque dans leurs balbutiements comme, par exemple, les possibilités techniques ouvertes par l’ère numérique qui commençait son essor.
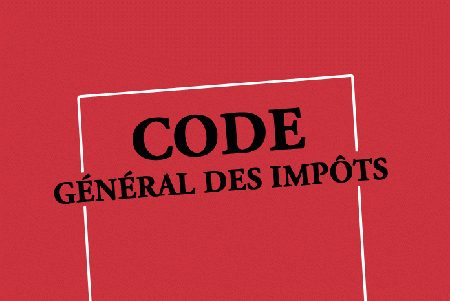
Chacun le sait, la matière fiscale possède les mêmes vertus adhésives que le sparadrap du capitaine Haddock dans « L’affaire Tournesol » d’Hergé, une fois collée, impossible de s’en défaire ! Aussi l’administration fiscale dont la méticulosité n’a d’égale que sa ténacité dans la précision de ses injonctions a-t-elle depuis ajouté une couche supplémentaire dans cette réglementation des œuvres d’art et quelques pages aux textes administratifs en vigueur. Le « Bulletin officiel des finances publiques-impôts » du 11 avril 2014, précise donc dans son Titre 9 – Chapitre 1 – Définitions – II :Œuvres d’art – Définition B : Gravures, estampes et lithographies originales : « 150 – Sont classées dans les œuvres d’art les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique. Les gravures, estampes et lithographies originales sont des épreuves tirées, en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement conçues et exécutées à la main par le même artiste.
Les gravures sont généralement exécutées en taille-douce, au burin, à la pointe sèche, à l’eau-forte, au pointillé.
Seules les épreuves répondant à ces conditions ont droit à l’appellation « œuvres originales ».
160 – En ce qui concerne le tirage limité mentionné au II-A § 130, il est à noter que, d’une manière générale, les artistes éditeurs limitent le tirage des gravures, lithographies et estampes ; celui-ci n’excède pas quelques centaines et le numérotage n’est pas constamment pratiqué. Dès lors, il n’a pas paru opportun de fixer une limite précise.précise. Ainsi, c’est seulement dans le cas de tirages excessifs par rapport aux usages normaux de la profession que le régime des œuvres d’art serait refusé à ces productions.
170 – En tout état de cause, la qualité d’œuvre d’art n’est pas reconnue aux gravures, estampes et lithographies réalisées par un procédé mécanique ou photomécanique, même si ces reproductions sont numérotées et signées par l’artiste ; il en va de même pour les tirages par planches, plaques ou cylindres d’imprimerie. »
Diantre ! Que voilà une belle discipline réglementaire ! Elle a pris un bel embonpoint administratif depuis le décret d’application de 1994. Mais qui veut trop embrasser mal étreint. À l’évidence, le fisc court derrière les pratiques contemporaines de l’art de l’estampe et y perd le souffle. Ces pratiques, fort heureusement pour cet art, sont aujourd’hui bien plus diversifiées et plus inventives. Elles intègrent bien souvent les derniers progrès technologiques, surtout parmi les jeunes générations stampassines friandes de mêler le médium estampe à bien d’autres. Les objets que créent ces pratiques sont des œuvres d’art à part entière et revendiquées comme telles par les artistes qui les conçoivent même si le public, les critiques d’art, les historiens d’art ou d’autres experts peuvent dénier ici ou là leur qualité esthétique. Ne serait-il alors pas plus sage de laisser le soin à ces artistes de proclamer par leur simple signature que ces œuvres stampassines sont de l’art ? Ne s’agit-il pas là d’une des conditions d’une libre création, c’est à dire de l’exercice d’une liberté qui ne nuit à personne?2
Au moment où est célébré la dixième Fête de l’estampe, prenons garde d’enfermer l’estampe, comme œuvre d’art, dans des codes esthétiques, éthiques ou fiscaux. En effet, cette fête annuelle commémore l’édit dit de Saint-Jean de Luz dont une des principales conséquences était de confirmer l’estampe comme un art libéral, c’est à dire non assujetti aux règlements contraignants, tatillons et conservateurs des corporations de métiers de l’Ancien régime. Cet édit laissait de plus les stampassins d’alors libres de leurs manières : « […] la graveure en taille-douce au burin et à l’eau-forte, qui dépend de l’imagination de ses autheurs, et ne peut être assujetty à d’autres loix que celles de leur génie […] »3. Ainsi jadis disait cet édit. Ainsi aujourd’hui ne pourrait-on pas dire que l’art de l’estampe ne saurait être contraint que par les seules lois du talent de ceux qui le pratiquent ?
Claude Bureau
1 – Michel Melot « Les vertus de l’originalité », article de Sciences Humaines, hors-série n° 37, juin-juillet-août 2002.
2 – On pourra objecter que cela serait la porte ouverte à toutes sortes de fraudes, faux et escroqueries mais quel règlement a-t-il pu empêcher tout cela dans le domaine de l’art dont l’histoire fourmille de tentatives de faux plus ou moins croustillantes où les plus grands experts se laissaient souvent berner ?
3 – Extrait de l’arrêt en conseil d’État du 26 mai 1660, dit édit de Saint-Jean de Luz (voir ici).
Nota bene : ce nouvel et troisième écho n’épuise pas le sujet traité : la signature de l’estampe. Faites-nous part de vos réflexions ou de vos témoignages à ce propos. Le magazine se fera un plaisir de les publier. Comment faire ? Voir ici. La rédaction.


