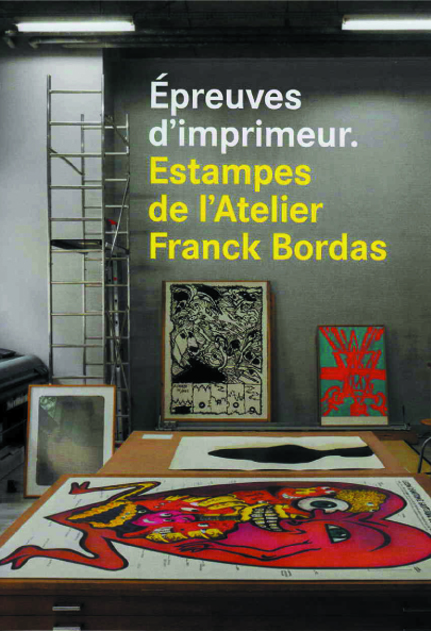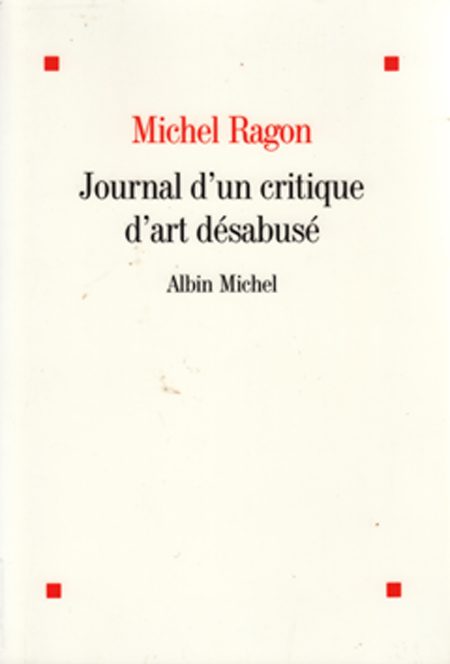Galerie Schumm-Braunstein
9 rue de Montmorency
75003 Paris
14 septembre-20 octobre 2018
Certains connaissent beaucoup plus Éric Fourmestraux par ses estampes que par les autres domaines artistiques dont il use pour s’exprimer. Amoureux de la chose imprimée et passionné de typographie, il met souvent en scène l’estampe dans des ensembles multiformes particulièrement bien construit à dessein. Cette récente exposition personnelle : « Portraits de famille », le montre d’autant plus qu’il a su, ici, fendre l’armure de son graphisme impeccable et laisser poindre ses passions, ses douleurs, ses amours qui s’entremêlent au fil du temps et que cette mise en espace rend d’autant plus poignantes.
Dès l’entrée de la galerie, le fac-similé photographique de la monumentale cheminée du château du Plessis-Trévise donne le ton. Le visiteur n’entre pas là dans le badin. Deux, voire trois, visages le regardent. « Le troisième jour (à Philippe F.) », pointe sèche toute en tailles douces sur fond immaculé, expression pensive et quelque peu inquiète. L’un dans le médaillon mouluré du manteau de la cheminée ; l’autre en un puzzle qui s’éparpille sur le rideau de fer de l’âtre, rideau tombé définitivement sur la vie de son père dont la main droite protège son regard vers ceux qu’il a aimés.

En entrant (Cl. Éric Fourmestraux)
Presque face à face, entre l’entrée et la devanture, un grand portrait en pied, sa mère, lui répond : « Rester debout (à Françoise F. née Bégué) », pointe sèche gravée sur briques de lait déployées. Une évocation sensible et pudique de la volonté et du désespoir face au naufrage de la vieillesse et de la maladie.
Puis, sur la gauche, dans la lumière de la vitrine, vibre comme en contrepoint de cette vie cessante, le séduisant portrait aux crayons d’une pulpeuse repasseuse, Juliette, son amoureuse, qui semble vouloir lisser avec son fer le portrait d’une autre repasseuse qui a été roulée par le destin.
En respiration, une série d’estampes de petit format se proposent à la vue : des portraits à la pointe sèche qui associent à chacun un objet familier ou préféré, le tout siglé du point rouge d’Éric. Parmi eux, toujours, celui de Juliette accompagnée d’un flacon de parfum au ventre arrondi. D’autres œuvres, plus ou moins discrètes, disposées ça et là entre quelques antiques portraits de famille.
Au fond de la galerie, on s’arrête volontiers pour de nombreux instants devant l’étrange machinerie de Patrick Tresset qui frétille, trépidante et lancinante, face à un Éric Fourmestraux immobile et stoïque. L’automate, avec ses capteurs affolés et ses bras articulés, lui tire trois portraits-robots dont l’un a été reproduit, trait pour trait, par Éric.en trente estampes intitulées : « EF par Patrick Tresset ». La notion de portrait est ainsi mise en un abîme où un automate portraiture l’artiste qui reproduit manuellement le dessin mécanique du robot sur une estampe, tel un possible auto-portrait automatique de l’artiste et ainsi de suite…

En sortant (Cl. Éric Fourmestraux)
Enfin, au sortir de la galerie, ne pas rater, non la marche, mais en pivotant de 270° sur la droite, collée sur le mur extérieur de la galerie et offerte aux regards des passants, une frise en reprise des images imprimées par Éric Fourmestraux, frise où, avec le temps, tout passe, trépasse et s’efface.
Une exposition qu’il ne faut pas manquer même pendant le fric-frac de la Fiac.*
Claude Bureau
* Allusion à une autre œuvre présentée et accrochée à une patère : « é(f)ric et fiac », taille d’épargne et découpe, 74 exemplaires.